Camp A en court métrage
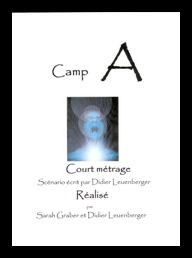
Le camp A.
Un projet audacieux qui demanda en premier lieu, beaucoup de sérieux et de documentation pour ne pas écrire n’importe quoi. Le premier livre en fait, ou je m’impliquai avec autant d’archives, puisque j’y traite de la déportation des minorités comme les homosexuels, les handicapés ainsi que les contestataires de tous bords défiant la patrie.
De ce roman en découla un premier scénario, puis un second, beaucoup plus court, afin de pouvoir réaliser un court métrage sans enlever l’ambiance inquiétante et le mystère de cette histoire. Le projet en est aux prémices, ayant rencontré une metteuse en scène désireuse de s’associer à ce projet, mais le temps manque, aussi, je ne sais pas si ça se fera ou pas mais j’ai grand espoir, quand à ce qu’un jour cette histoire soie porté à l’écran ou publié sous forme de livre ou mieux encore, de BD. Avis aux amateurs concernés par ce sujet important, et pensant que le travail de mémoire n’est pas juste une bougie allumée une fois tous les dix ans mais un travail de tous les instants, voir un devoir pour les générations qui suivent…
Extrait du roman :
Il y a le mugissement des vagues au loin et le chuintement du vent. Comme un murmure réconfortant. Une brise rafraîchissante.
Il y a le silence aussi. Pesant, s’incrustant comme de la suie. S’imprégnant dans les moindres recoins.
Il y a cette bâtisse, minuscule en soit, donnant la main à l’étrange, semble-t-il. Faite de rondins de bouleaux, elle prône seule au milieu de nulle part. Là, dans ce no man’s land du nord de l’Allemagne. Un endroit perdu, oublié. Oublié par le temps lui-même.
Aucune route n’est visible, aucun chemin. Pas le plus petit sentier. Des fourrés et des buissons chargés de baies entourent ce lieu insolite, comme pour le protéger, comme pour le cacher, le dissimuler… Quelques fougères plus ou moins alignées tentent de lui donner un aspect de jardin dompté, mais il n’en est rien en vérité.
L’image est floue, tantôt noire et blanche, tantôt d’une teinte sépia et survenant dans l’esprit de Klaus par flashs, comme par accident. Un accident malencontreux qu’on aimerait ne plus avoir en mémoire et dont on ne peut se défaire. Un patchwork d’images collées les unes aux autres et dans le désordre. Un empiècement de représentations se moquant bien du temps.
Il y a les cris. Des cris horribles, semblant surgir de l’au-delà. D’outre-tombe.
Klaus est nu, couché sur une sorte de lit fait de vieilles lattes coupées dans du saule. Ses jambes sont maintenues écartées par un bout de taule, lui écorchant la chair au moindre mouvement. Des pinces emprisonnent ses tétons tandis qu’une autre s’acquitte fièrement de ses organes génitaux.
Lorsqu’il reprend conscience, une coulée d’eau lui est lancée sur le torse à moins que ce ne soit de la pisse, afin que la décharge qui va lui être lancée soit plus cruelle, plus douloureuse, plus intolérable.
L’image est de plus en plus confuse et trouble, seules les bottes des soldats et de l’officier sont nettes. Les visages sont imperceptibles. Méconnaissables. Un embrun enrobe ce rêve et les protagonistes de ce même cauchemar, comme s’il tenait à masquer quelque chose. Une authenticité cruciale, un sacre à ne pas violer, sous peine de ne jamais plus retrouver le moindre petit souffle, mais surtout, d’y perdre la raison.
L’officier SS se tient devant lui. Il reconnaît ses bottes, plus hautes que celles des deux autres soldats. Plus brillantes. Droit comme un I, insensible au spectacle, insensible à la souffrance qu’il est en train de lui faire subir.
Klaus a beau hurler ses tripes, hurler la mort, personne ne viendra et au vu du plaisir qu’éprouvent ses deux bourreaux, des nazis plus fous que tous les fous réunis du plus grand asile jamais connu en Allemagne, personne ne parviendra à le sauver sinon une mort salvatrice.
Les yeux exorbitants des deux soldats se dévoilent, se précisent un très bref instant et laissent transparaître le malin lorsqu’ils daignent regarder le prisonnier qu’ils torturent, s’encourageant et plastronnant en se lançant des vannes, gonflant ainsi leur orgueil de mâle. Seul leur regard est perceptible. Tout le reste du visage se pare d’un aspect vaporeux.
Klaus n’est plus qu’un bout de chair, grillant au rythme des supplices endurés. Il ne sent plus ses pieds, plus ses mains, plus ses jambes, plus même sa tête, ils se sont arrangés pour la frapper à coups de pelle, comme si cela ne suffisait point.
Une odeur de roussi s’empare des lieux, après qu’ils lui aient lancé la dernière décharge. Klaus a à peine le temps de voir que ses doigts n’ont plus d’ongles et l’un des chiens dévorer un membre de… Non ! supplie-t-il en fermant les yeux et espérant avoir imaginé ce qu’il vient de voir, mais il sait qu’il n’à point rêvé. C’était bien un bout de bras. Un bras. Pas le sien. Quoique s’il s’agissait de son membre, il n’aurait la force de crier tout son effroi. Et combien même, sentirait-il quelque chose ?
Un des soldats vient vers lui, le regard méchant, une seringue à la main, il la lui plante dans l’aine sans hésiter.
Mais la douleur ne veut plus rien dire à ce stade. Il n’a plus de larmes pour pleurer. Il se laisse aller en espérant ne plus jamais se réveiller, sombre dans l’inconscient, à moins que ce ne soit la potion qu’on vient de lui injecter qui lui fasse perdre connaissance.
« Voilà… Chut ! Chut ! » souffle Anna, en posant sa main sur sa poitrine et en le berçant gentiment. Klaus ouvre les yeux, observe le plafond vétuste de cette bâtisse. La moisissure telle une vérole, envahit le bois sans vergogne.
Il cligne plusieurs fois des paupières avant de poser son regard sur Anna. Il a de la peine à revenir à lui, à se défaire de ce rêve, à moins que ce ne soit des songes ou pire…
Il ne comprend pas. Ni ses cauchemars qu’il lui semble toujours avoir fait, ni cette prison dans laquelle on les maintient pour Dieu sait quelle raison.
Un son de voix, un chuintement est perceptible de l’autre côté de la pièce. Les deux prisonniers tournent la tête en même temps vers le bourdonnement en question. Klaus se penche pour tenter de distinguer qui en est l’auteur.
Une silhouette se dessine dans la faible lumière qu’un jour timide a toute la peine du monde à léguer dans cette chambrée. Les vasistas, minuscules et n’ayant jamais été lavés, semble-t-il, ne suffisent à laisser croire qu’il fait jour dehors, tant il fait sombre. Très sombre. La fenêtre, la seule fenêtre de cette bâtisse ne paraît en fait, qu’être un empiècement de la paroi laissant à peine entendre le clapotis de la pluie lorsque celle-ci tombe.
Un corps voûté, assis sur le sol, se balance d’avant en arrière. Un corps maigre, rachitique. Une de ses mains tendues au-dessus de la tête, l’annulaire et l’index levés et tremblotant nerveusement sans discontinuer.
La jeune femme et Klaus soupirent en l’observant. Soulagés ou déçus, ils n’arrivent à décrire ce qu’ils ressentent, mais une chose est certaine, ils préfèrent se heurter à Franz plutôt qu’à l’un de ces soldats devenus fous à lier.
«Quel débile », se dit Anna, en observant le handicapé compter à voix haute et n’osant les regarder autrement que par-dessous son épaule. Des œillades obliques emplies de crainte et d’appréhension.
Elle secoue la tête, revient à Klaus en souriant timidement. « Un cauchemar ? » demande la jeune femme blonde d’une voix douce et chaleureuse. « Je… » tente de répondre Klaus en se frottant la tête et en observant ses doigts. Ses ongles sont bien en place. Son torse n’a aucune trace apparente de brûlures et son visage est assurément vierge d’ecchymoses et de boursouflures, sinon, elle ne le considérerait pas ainsi.
Il soupire bruyamment sous le geste de la main de la jeune femme, lui montrant du regard, les autres lits. Aucune tête ne dépasse des châlits, mais les matelas sont bien tous occupés. Malheureusement pour eux, songe Anna, en se mordant la lèvre inférieure.
Combien sont-ils dans cette chambrée ? Six, sept ? s’interroge-t-elle silencieusement en tentant de se rappeler chacun de ses compagnons survivant à ses côtés depuis … Oh ! Mon Dieu, même ça, elle n’arrive pas à s’en souvenir…
Un courant traverse la pièce, sa mèche ondule comme une voile au vent. Elle la remet sur sa tête en souriant. Klaus tente de lui rendre la pareille, mais son rictus est bref et plein d’inquiétude. Il s’assoit dans son lit, laissant tomber ses jambes dans le vide, au-dessus de la tête de son voisin de dessous. Anna lui frotte l’avant-bras pour le réconforter. Il reste songeur. Semble ailleurs. Dans un autre monde.
« On nous drogue Anna ! » chuchote-t-il à l’oreille de la jeune femme, en lui lançant un regard sombre. « On nous drogue tant et si bien que nous ne savons plus depuis quand nous sommes dans ce camp. Que nous ne savons plus même pourquoi nous y sommes arrivés ! Que nous ne savons même plus qui nous sommes.
© 2008 - Didier Leuenberger - Tous droits réservés.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 106 autres membres



